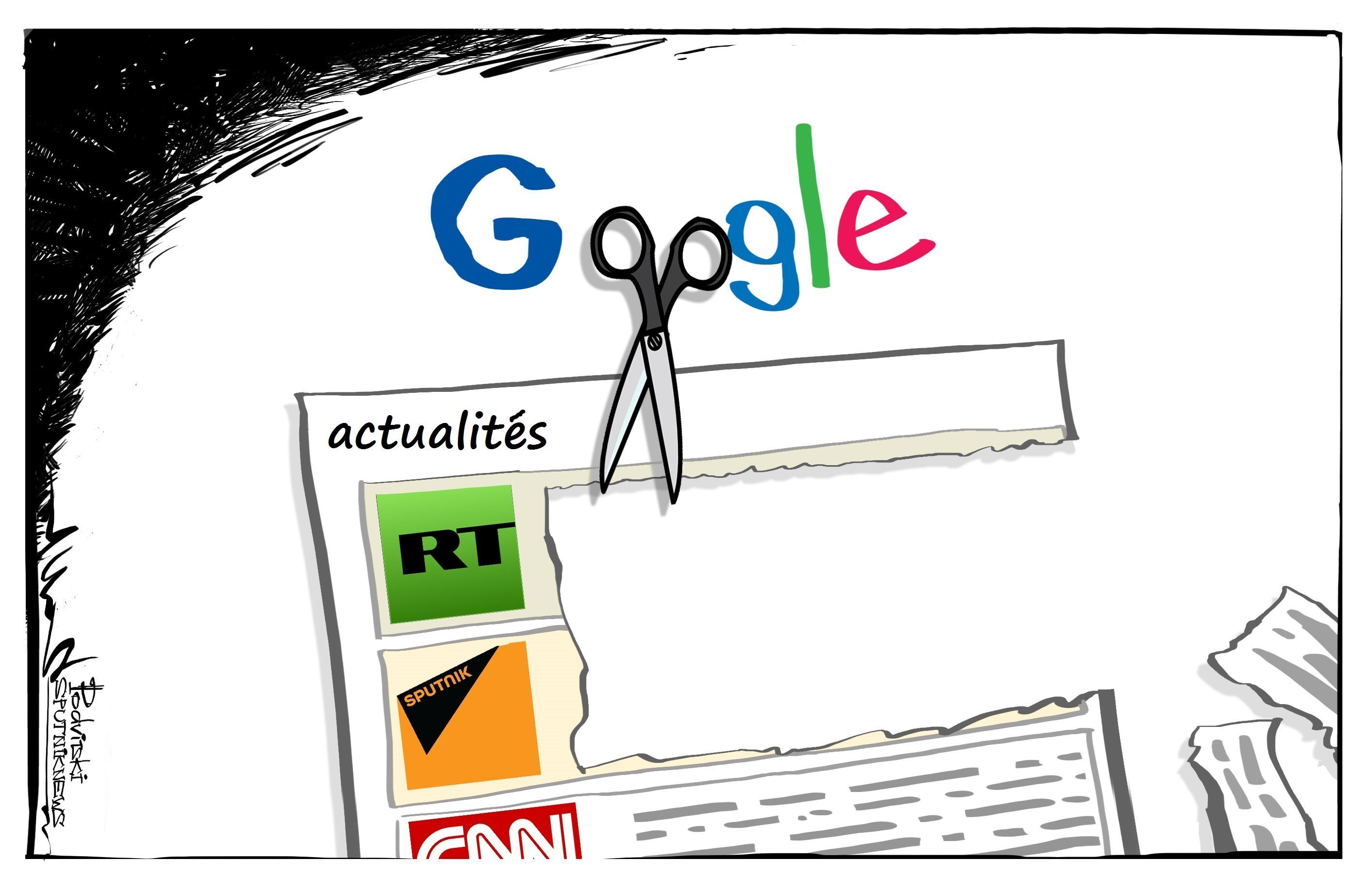Comme dans la série de navets cultes Souviens-toi l’été dernier, nous avons parfois tendance à omettre trop facilement les vilains souvenirs. Prenez le 11 septembre 2001 par exemple, la destruction du World Trade Center a tellement bouleversé les rapports géopolitiques et initié plusieurs conflits à l’échelle globale que nous en avons presque oublié notre manière de voir le monde d’alors.
Tout cela semble à la fois loin et proche. Les évolutions de cette longue guerre contre le terrorisme et/ou – entre autres ?! – en Afghanistan nous ont fait perdre de vue ce qui était annoncé dès les premières heures : le choix d’un camp, la nomination d’un ennemi, des ruptures dans le monde musulman ou encore l’arrivée des drones armés sur le champ de bataille. Replongeons brièvement, par curiosité, dans les archives de ces drôles de semaines.
Un bourbier ? Vous étiez prévenus !
Nous avons eu largement tendance, ces dernières années, à interroger l’enlisement des forces de la coalition en Afghanistan. La couleur avait pourtant été annoncée dès le départ par les autorités américaines. « C’est peut-être une guerre qui n’aura pas de fin, du moins pas de notre vivant », annonçait Dick Cheney, vice-président de Bush Junior, le 23 octobre 2001. Donald Rumsfeld, le secrétaire d’Etat à la Défense, avait lui aussi prévenu une semaine après les attentats. Le 18 septembre, il estimait que cette guerre s’étendrait « non sur des semaines ou des jours, mais sur des années ».
Un autre esprit « éclairé » anticipait la complexité de cette crise. Longtemps avant la redécouverte des stratégies de contre-insurrection, notamment françaises, et de la fameuse guerre pour les cœurs et les esprits, un chef d’Etat qui serait beaucoup plus tard confronté au problème croyait comprendre la logique de vengeance qui nourrirait les rangs de la rébellion afghane. « Admettons qu’il y a aujourd’hui 10 000 terroristes à travers le monde, expliquait-t-il le 1er octobre 2001. Au lendemain de frappes militaires qui seraient considérées comme un succès, il y en aura 100 000. Si c’est un échec, il y en aura un million. » Il s’agissait d’un certain Bachar al-Assad.
Et soudain, la guerre des drones fût
« L’armée de l’air américaine a utilisé pour la première fois, au dessus d’une zone non précisée en Afghanistan, un engin automatique de reconnaissance (drone) armé. Il s’agit d’un Predator. » Notez le terme, si peu sexy, employé à l’époque : un engin automatique de reconnaissance armé. Le Monde évoquait ainsi le 20 octobre 2001 les débuts de ce qui est devenu aujourd’hui l’un des principaux outils de la guerre contre le terrorisme. De Bush à Obama, le fameux Predator est devenu une star. Son missile antichar Hellfire aussi.
Le quotidien français ne lui consacrait pourtant qu’un petit encadré. Pas de quoi fouetter un chat. Le Monde était alors beaucoup plus fasciné par les AC130 H et U, les fameux « spectres » et autres « spooky », canonnières volantes capables de déployer une puissance de feu colossale et dissuasive. C’est vrai qu’une baleine volante avec une gatling dans le derrière, c’est autrement plus sexy qu’un petit machin invisible et silencieux.
La France et l’incompétence en matière de communication politique
Dans les premières semaines du conflit en Afghanistan, la France s’illustre par un véritable fiasco sur le plan de la communication. Dans un contexte de cohabitation, le président Jacques Chirac et le Premier ministre Lionel Jospin ne cessent d’envoyer des messages contradictoires.
Le 20 septembre, le chef de l’Etat annonce, en visite à Washington, que la France est prête à une « action militaire commune ». Le chef du gouvernement, lui, se fait moins affirmatif : il estime qu’il faut d’abord étudier la liste des demandes américaines pour voir ce qui est concevable ou non. Il annonce également un vote au Parlement qui finalement, sera ajourné. Pour les explications, vous repasserez.
Côté ministère de la Défense, ce n’est pas beaucoup mieux. Le ministre, Alain Richard, peine à exister dans les médias. On comprend vite que ce n’est pas lui qui décide. Il révèle pourtant régulièrement des détails croustillants : mi-octobre, il ne cache pas que des forces spéciales françaises vont participer aux opérations terrestres… quand le reste du gouvernement refuse de se prononcer sur le sujet.
Et pendant ce temps, la cellule de crise tourne à plein régime. Diplomates, militaires et conseillers se coordonnent comme ils peuvent mais arrivent tant bien que mal à pousser leurs efforts dans la même direction. Ce qu’ils pensent de la parole de leurs chefs d’alors ? « Le drame, lâche un diplomate du quai d’Orsay au Monde, c’est qu’il faut bien qu’ILS parlent. » Tout est dit.
Et paf, ca fait des terroristes
Avec tout ca, les talibans se sont retrouvés dans le mauvais camp. Leur chef, mollah Omar, n’aurait pas du soutenir Oussama Ben Laden. Si en 2000 et 2001, jusque septembre, la presse parlait des « autorités afghanes » ou du « gouvernement » afghan, ces qualificatifs disparaissent dès après les attentats. Les talibans ne sont plus dès lors que la « dictature des talibans », pour reprendre les mots d’Alain Richard début octobre 2001.
Du coup, humanitaires, journalistes et autres diplomates sont gentiment invités à quitter le pays. Américains et Britanniques sont clairs : il faut choisir son camp. « Nous ne ferons pas de distinctions entre les terroristes et ceux qui les protègent », annonçait le président Bush le jour même des attentats. « Je voudrais dire à notre peuple que notre jihad va officiellement reprendre contre les Américains », préférait prévenir le mollah Mohammad Hassan Akhund quelques jours plus tard.
Et Ben Laden dans tout cela ? On le découvrait enfin « terroriste ». Jusque là, l’ancien meilleur ami de la CIA face aux Soviétiques n’était qu’un « millionnaire », parfois « milliardaire », voir même un « islamiste extrémiste » ! Il était pourtant déjà soupçonné d’être l’un des principaux responsables du premier attentat contre le World Trade Center (1993 / 6 morts), puis de ceux qui ont visé les ambassades de Nairobi (1998 / 213 morts), de Dar es-Salam (1998 / 11 morts) et du navire militaire USS Cole (2000 / 17 morts).
Très peu connu jusque là, le patron du réseau tout aussi peu célèbre Al Qaida, se retrouve placardé « ennemi public numéro 1 ». Dire qu’un an plus tôt, le 3 mars 2000, le magazine hongkongais Asiaweek le disait « condamné » par son état de santé, même s’il dirigeait toujours vaille que vaille ses « partisans » en Afghanistan…
Relativisme de la perception stratégique
Ces quelques exemples nous permettent de comprendre comment notre perception du monde stratégique qui nous entoure peut être à relativiser. La menace terroriste, les jeux d’alliances politiques, l’urgence de tel ou tel conflit peuvent assez facilement basculer en cas d’événement imprévu. Ce fût le cas lors de l’assassinat de l’archiduc François Ferdinand à Sarajevo, de l’attaque de Pearl Harbor ou encore du 11 septembre.
Attention, donc, aux affirmations que l’on peut tenir lorsque l’on se lance dans un exercice d’analyse : la perception et l’évidence n’engagent finalement que ceux qui les croient. Allez donc savoir, finalement, si la Chine est un géant en devenir, si les Etats-Unis sont notre meilleur allié… ou si la guerre est si loin de nous.




 Share On Facebook
Share On Facebook Tweet It
Tweet It