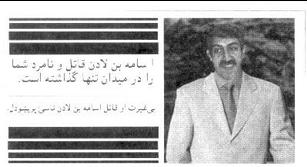Guernica est certainement l’une des oeuvres les plus connues de Picasso. Le peintre y a posé, sur la toile, les émotions ressenties après le bombardement de la ville éponyme, en 1937, lors de la guerre d’Espagne. Le 26 avril, les nationalistes, appuyés par des militaires de l’Allemagne nazie et de l’Italie fasciste, déclenchent le feu sur la petite ville. Une soixantaine d’avions des alliés de Franco ont lâché les bombes sur des habitations civiles, causant la mort de plusieurs centaines de personnes, pour un enjeu stratégique considéré comme faible par la plupart des historiens.
Ce qui nous intéresse ici est la motivation de Picasso pour réaliser cette toile qui doit dénoncer, dans le style propre à cet artiste, l’impuissance et la douleur des victimes. Une phrase très intéressante est attribuée au peintre:
La peinture n’est pas faite pour décorer les appartements, c’est un instrument de guerre offensif et défensif contre l’ennemi.
Picasso avait choisit son camp. Il désignait sa peinture comme une arme déployée directement contre « l’ennemi« , les régimes nationaliste, nazi et fasciste. Un choix qui parait parfaitement évident à l’aube du XXIème siècle mais qui l’était certainement moins dans les années 1930, alors que l’Europe se précipite vers le sombre avenir qui l’attend.
Le peintre espagnol n’était d’ailleurs pas le seul à avoir ainsi choisit son camp. A la même époque et au même endroit, un certain Robert Capa photographie la guerre d’Espagne. Le photographe américain, véritable légende pour les photo-journalistes en particulier, mais aussi les journalistes en général, est pourtant loin de la neutralité que l’on défend aujourd’hui dans la plupart des rédactions: communiste revendiqué, il est financé par différents bureaux politiques et revues de propagande qui lui achètent ses images sensées dénoncées les horreurs du camp nationaliste.
Des tords que l’on n’hésite pourtant pas à reprocher, notamment aux rédactions anglo-saxonnes, dès lors qu’elles hésitent à aborder certains aspects des conflits récents, en Irak ou en Afghanistan. Les plus grands journaux américains ont été soupçonnés et ont parfois admis avoir opté pour l’auto-censure, de peur de tenir des propos trop ravageurs pour le moral des boys déployés sur ces théâtres.
L’idéal de neutralité
La notion d’objectivité est quelque chose de récent, pour les médias. Certaines rédactions continuent d’entretenir une longue histoire d’orientation idéologique mais cherchent tout de même à la rendre la plus discrète possible. Des quotidiens comme Libération ou Le Figaro, pourtant riches d’une grande tradition politique, mettent à présent en avant la neutralité des informations qu’ils diffusent.
Mais qu’est-ce que cette neutralité? Chaque information, chaque image a un sens. Diffusée au nom de la liberté d’informer, elle a des conséquences stratégiques qui vont au delà de nos volontés de partager le savoir avec les masses. La plupart des reporters parviennent assez facilement à mettre de côté leurs opinions politiques ou religieuses: on peut très bien aller à la rencontre d’activistes libertaires tout en étant un libéral convaincu.
Il reste pourtant beaucoup plus difficile de traiter certains sujets avec neutralité: combien de journalistes peuvent aborder le drame tibétain, la situation des femmes afghanes ou encore les libertés sexuelles en Russie tout en considérant de manière équilibrée les différents points de vue? De telles thématiques sont riches pour nous, Européens et Occidentaux, de toutes les valeurs que nous avons historiquement défendu. Une incompréhension totale chez nos amis Chinois, Pachtounes ou Russes dont les modèles de pensée, culturels et historiques, sont très différents.
Comment affirmer que nos valeurs sont meilleurs que les leurs? L’intime conviction d’un héritage idéologique et humain, transmis de génération en génération?
A Bayeux, dans le cadre du prix des reporters de guerre, la citation de Picasso éclaire une exposition du photographe américain James Nachtwey. Une longue série de photos en noir et blanc, prise dans un hôpital militaire américain en Irak. Ce journaliste passe pour l’un des meilleurs de sa génération. Qui oserait lui reprocher, par cette illustration de l’impuissance et de la douleur d’hommes, principalement des soldats mais aussi une poignée de civils, de défendre un camp particulier? L’exposition ne dit pas qui, pour ce photographe, est l’ennemi. Peut-être lui-même n’en est pas certain.
Toujours est-il que les images nous rappellent, chaque fois que nous les voyons, qu’il y a un ennemi. Reste à savoir si certains clichés ne désignent pas, en chacun de nous, un coupable différent. Des miliciens irakiens verraient probablement comme responsable de ces scènes d’horreur ceux qui, à Washington, décidèrent de l’intervention en Irak. Des Américains y percevraient plus certainement les conséquences des ambitions terribles d’un certain Oussama.
Triste dialogue de sourds qui semble ne laisser comme conclusion que celle ressentie face à la toile de Picasso: l’impuissance et la douleur.

 Share On Facebook
Share On Facebook Tweet It
Tweet It